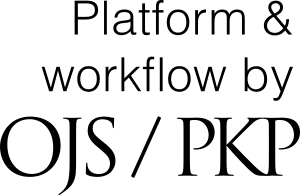PRISE EN CHARGE DU VIOL POST-CONFLIT AU BURUNDI: REGARD SUR LES PRATIQUES MOBILISEES PAR LES ACTEURS
DOI :
https://doi.org/10.71105/1rq2h413Mots-clés :
Viol post-conflit, acteur social, prise en charge, chaine pénale, groupement communautaire de solidaritéRésumé
Contexte : le Burundi sort d'une longue période de conflit armé dont les conséquences incluent des violations des droits humains, en l’occurrence le viol commis contre les femmes et les filles. Ce viol est aujourd’hui criminalisé par le code pénal au Burundi. Objectif : cerner les pratiques des acteurs impliqués dans la prise en charge du viol post-conflit au Burundi ainsi que les logiques qui les sous-tendent. Méthodologie : cette étude est de nature qualitative et a été menée dans une démarche inductive. Les données ont été collectées à l’aide d’entretiens semi-directifs. Résultats : l’étude révèlent une diversité de pratiques sous-tendues par plusieurs logiques. Les acteurs des centres de prise en charge des victimes de viol font preuve de respect des règles de la profession médicale dans leurs pratiques, mais sont parfois influencés par des stéréotypes et coutumes du patriarcat. Les acteurs de la judiciarisation du viol, procèdent par pénalo-centrisme, mais s’adonnent à des pratiques alternatives à la norme pénale, par le biais de pratiques extrajudiciaires. Les pratiques des acteurs communautaires et les logiques qui les sous-tendent dépendent de leurs groupes et des enjeux défendus par chacun de ces groupes. Conclusion : il est noté un maillage de pratiques s’enracinant dans des influences du patriarcat et dans une norme pénale dont l’application est parfois fonction des logiques défendues par les acteurs. Ces résultats incitent à réfléchir sur les modalités d’un changement de paradigme en vue d’une prise en charge des victimes de viol affranchie de victimisations secondaires.
Références
Alliot, M. (2003). Le droit et le service public au miroir de l’anthropologie. Paris: Karthala.
Assepo, E. A. (2000). Les modes extrajudiciaires de règlement des litiges en Côte d’Ivoire.
Verfassung und Recht in Übersee/Law and Politics in Africa, Asia and Latin America,304‐332.
Bernard, L. (1998). L’homme pluriel. Les ressorts de l’action. Paris: Nathan.
Blais, M., & Martineau, S. (2006). L’analyse inductive générale : Description d’une démarche visant à donner un sens à des données brutes. Recherches Qualitatives, 26, 1-18.
Bourdieu, P. (1998). La domination masculine. Paris: Ed. du Seuil.
Cario, R., & Ruiz-Vera, S. (2015). Droit (s) des victimes : De l’oubli à la reconnaissance. Paris: L'Harmattan.
Debuyst, C. (1992). Les paradigmes du droit pénal et les criminologies cliniques. Criminologie,25(2), 49‐72.
Demazière, D. & Dubar, C. (1997). Analyser les entretiens biographiques. L’exemple de récits d’insertion. Paris : Nathan.
Gasibirege, S. (2013). Comprendre les violences sexuelles massives et répétitives. Manuels d’initiation. Kigali, Rwanda: Publications de l’Institut Africain pour la Psychologie Intégrale.
Garnot, B., 2000, Justice, infrajustice, parajustice et extrajustice dans la France d'Ancien Régime, Crime, Histoire & Sociétés / Crime, History & Societies, 4, 1, 103-120, [en ligne] DOI : https://doi.org/10.4000/chs.855
Gauthier, B. & Bourgeois, I. (2016). Recherche sociale : De la problématique à la collecte des données, 6è édition, Québec : Éditions de l’Université du Québec.
Kienge-Kienge Intudi, R. (2010). Le contrôle policier de la délinquance des jeunes à Kinshasa : Une approche ethnographique en criminologie. Louvain-la- Neuve : Bruylant- Academia.
Le Roy, É. (2004). Les Africains et l’Institution de la Justice : Entre mimétismes et métissages. Paris: Editions Dalloz.
Lahire, B. (1998). L’homme pluriel. Les ressorts de l’action. Paris : Nathan.
Lechenne, J. (2012). Violences sexuelles à l’encontre des femmes en situations de conflit et de post-conflit : La procédure d'asile en Suisse vue sous l’angle d’un continuum de la violence. [PhD Thesis : Université de Lausanne].
Llanta, D. (2019). La protection de l’individu contre les violences sexuelles : De la prevention à la réparation au sein de l’ordre juridique international et des systèmes nationaux [PhD Thesis, Université de Perpignan].
Lopez, G. (2019). La victimologie. 3è édition, Paris : Dalloz.
Mathieu, N.-C. (1991). L’anatomie politique, Catégorisations et idéologies du sexe, éditions côté-femmes. Paris: Côte d'Azur.
Miles, M.B., & Huberman, A.M. (2003). Analyse des données qualitatives. 2è édition, Paris: De Boeck.
MSF(2009). Vies brisées. L’aide médicale urgente, vitale pour les victimes de violences sexuelles. Rapport de Médecins Sans Frontières, Centre opérationnel de Bruxelles.
Mucchielli, A (1996). Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines. Paris : Armand Colin.
Muriel, S. (2015). Violences sexuelles. Les 40 questions-réponses incontournables. Paris : Dunod.
Muriel, S. (2018). Le livre noir des violences sexuelles, 2è édition, Paris : Dunod.
Ndiaye, N. A. (2021). Violences basées sur le genre en Afrique de l’Ouest : Cas du Sénégal, du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Friedrich-Ebert-Stiftung Peace and Security.
Nduwimana, M. et Ndayisaba, J « Judiciarisation du viol post-conflit au Burundi ou quand la norme pénale coexiste avec des procédés de règlements à l’amiable », « Champ pénal», Varia, 27/2022, 29p. https://doi.org/10.4000/champpenal.13940
Pires, A. P. (2006). La criminologie d’hier et d’aujourd’hui. J.-M. Tremblay. Van Campenhoudt, L., Marquet, J., & Quivy, R. (2017). Manuel de recherche en sciences sociales : Vol. 5e éd. Paris: Dunod.